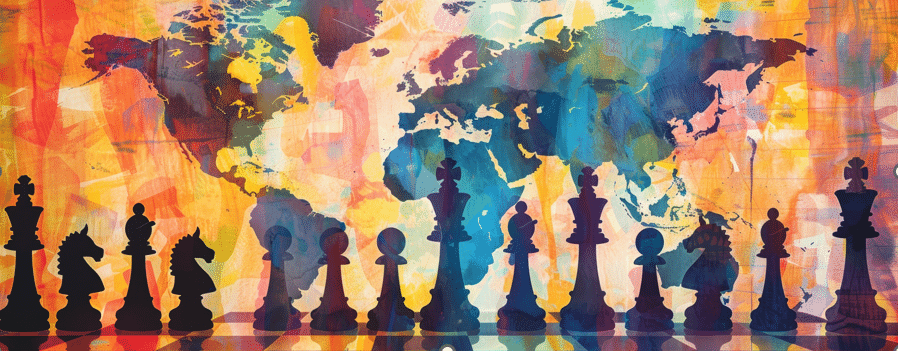Les évolutions géopolitiques ne sont pas souvent mises au cœur des problématiques du commerce. La prise de conscience des vulnérabilités liées à ces évolutions s’est cristallisée au travers de plusieurs événements récents, dont le cumul a permis leur compréhension par l’opinion publique. Même si celle-ci semble se limiter pour le moment au secteur industriel : « Suite au blocage de certaines chaînes logistiques consécutif à la crise sanitaire et aux conflits en cours (Ukraine, Gaza…), les pays européens ont pris conscience de l’importance de maîtriser certains approvisionnements stratégiques (médicaments, céréales, matières premières, [sources d’énergie]…)« [1]. Plus récemment les alertes répétées sur l’augmentation des droits de douanes et la montée des politiques protectionnistes et nationalistes ont renforcé cette prise de conscience.
Ces tensions géopolitiques restent le plus souvent perçues comme génératrices de problèmes d’approvisionnement, avec leurs conséquences directes en termes de perte de volumes de vente et à l’extrême, d’inflation et de baisse de pouvoir d’achat. Mais est-ce bien leurs seules conséquences ? Est-ce qu’à plus ou moins long terme, d’autres phénomènes, de nouveaux « cygnes noirs », ne sont pas en développement et dont une non-perception pourrait avoir des conséquences funestes pour le commerce et plus largement nos économies ?
Horizon 2035 : des questions d’approvisionnement à la remise en cause des modèles sociaux
La perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales va très probablement s’amplifier dans la prochaine décennie, portée de manière visible par les politiques protectionnistes de nombreux pays. Mais ces dernières ne doivent pas masquer des phénomènes plus profonds, aujourd’hui mal perçus, qui s’exprimeront de plus en plus fortement pour potentiellement s’instaurer comme les dimensions structurantes du monde à venir.
Vers une démondialisation de l’économie et des approvisionnements ?
Les discours alarmistes sur un risque de démondialisation se multiplient. A face renversée de nos habitudes, le président D. Trump dresse des barrières à l’entrée des produits étrangers dans un pays qui a assuré son développement économique par la mondialisation de son modèle de consommation, la célèbre « american way of life ». En écho, le vice-premier ministre chinois Li Qiang exprime son inquiétude concernant un risque croissant de démondialisation qui affaiblirait la croissance mondiale. Cette démondialisation est vécue comme une menace multidimensionnelle et complexe, tant au niveau de l’innovation technologique, de la croissance économique, de l’emploi, du pouvoir d’achat des consommateurs, que finalement de la survie des démocraties, telles que définies, au moins, en Occident ! Cette menace peut n’apparaître que limitée pour les enseignes et leur internationalisation. Après tout, nombreuses d’entre-elles ont assuré leur croissance dans toutes les formes de pays et de régimes politiques sans trop de difficultés. En revanche, les conséquences sur le pouvoir d’achat génèrent de fortes incertitudes pour la consommation des ménages.
Les questions pour les acteurs du commerce restent néanmoins nombreuses et anxiogènes. Pour les grands acteurs, elles se posent avant tout en termes d’adaptation aux conséquences économiques d’une guerre commerciale réelle ou virtuelle. Comment rendre les modèles économiques plus résilients ? Les risques pays pour les enseignes internationales deviennent prioritaires tant en termes de présence et de développement que de sources d’approvisionnement. La stratégie « China + 1 »[2] apparaît désormais insuffisante pour répondre aux enjeux de maîtrise des achats, surtout avec des injonctions croissantes de soutien aux productions nationales, voire locales. Pour les acteurs du commerce de proximité, indépendants et non-sédentaires, la question se pose peut-être moins en termes d’approvisionnement que d’inquiétudes des consommateurs, de crise de confiance et d’une perte de pouvoir d’achat qui pourraient avoir raison d’une consommation déjà atone.
Le compte à rebours de la bombe démographique est lancé !
Il y a encore quelques mois, la plupart des analystes et responsables d’entreprises étaient persuadés que nous allions vers une population mondiale qui dépasserait les 10 milliards d’habitants. Seules les zones occidentales (EU et USA) ou les plus riches (Japon, Corée du Sud) devaient voir leurs populations baisser (et vieillir) inexorablement. Mais voilà que le scénario le plus improbable dans les projections historiques de l’ONU se met en place : chute de la population mondiale sur tous les continents. En volume, la population chinoise serait la plus touchée avec une perte estimée à 600 à 800 millions d’habitants avant la fin du siècle. Le phénomène n’est pas pour après-demain ! Il est déjà enclenché avec des indicateurs de fécondité alarmants et une réaction forte du gouvernement chinois, notamment un fort décalage de l’âge de départ à la retraite[3] et une remise en cause de certaines pratiques de consommation, notamment dans le luxe. Bienvenue dans un monde vide !
Alors même que nous imaginions à court terme, une submersion de l’offre par les productions chinoises, les acteurs du commerce sont déjà obligés de se poser une question crue et inédite : que vendrons-nous demain ? Notamment sur la branche à bas coûts de production assurée par la Chine, comment assurer le sourçage et la production pour répondre à la consommation de « consolation »[4], qui reste l’un des seuls secteurs dynamiques du commerce ? Sommes-nous prêts à répondre à ce déficit potentiel d’offre qui pourrait arriver très rapidement en fonction des nouvelles orientations stratégiques et économiques chinoises ? Verra-t-on demain une réorientation de la consommation des vêtements (difficilement productibles à bas coûts, chez nous) vers la consommation d’accessoires, dont les créations restent plus compatibles avec des micro-productions originales et locales, voire l’auto-production ? Ce déficit prévisible de l’offre en produits physiques annonce-t-il une consommation accrue de services et/ou de produits vintage, customisés ou upcyclés ?
Les enjeux de l’évolution de l’offre face à celle des pratiques de consommation peuvent aussi s’apprécier au regard d’autres dimensions de la démographie, à savoir le vieillissement de la population ou encore l’évolution des structures familiales. Quel est l’avenir des enseignes positionnées sur les marchés de la famille, des enfants et des adolescents ? Quelles nouvelles enseignes pour les séniors et les grands séniors ?
La montée des protectionnismes : de l’économie à la défense des valeurs
Les évolutions démographiques occidentales expliquent en partie seulement la montée des protectionnismes. Si elles ne sont que rarement exprimées spontanément par la population, elles rejaillissent toutefois au travers d’interrogations que l’on retrouve dans de nombreux votes : la peur qu’une faiblesse démographique locale soit compensée par une population extérieure d’une part, un risque de disparition de modes de vie traditionnels avec l’émergence de nouveaux acteurs, d’autre part. Pour faire simple, si une démondialisation est surtout perçue au travers de ses conséquences, force est de constater qu’elle est aussi largement due à un rejet de certaines formes de libéralisme comme de libertarisme à l’échelle mondiale. Ces conflits entre intérieur et extérieur, ne concerne pas que les pays occidentaux. Ainsi, la Chine continue-t-elle de rejeter l’hypothèse d’une entrée de population extérieure pour combler certains de ses déficits démographiques à venir. On assiste alors à une évolution du principe même de protectionnisme. Historiquement marqué par la défense de l’emploi, celui-ci devient désormais la défense des valeurs ancestrales et des modes de vie.
On comprend assez bien les conséquences du protectionnisme en termes de production industrielle : limitation des flux de produits, de capitaux, voire de personnes, accent mis sur les productions locales, mêmes si elles sont inflationnistes à court terme, durcissement réglementaire pour assurer ces positions tant en termes de politiques intérieures qu’extérieures. Mais qu’est-ce que le protectionnisme quand on parle de commerce ? On observe aujourd’hui un jeu ambivalent des acteurs du commerce réclamant tout à la fois un protectionnisme face à des enseignes comme Temu et Shein et dans le même temps rejettent les droits de douane sur les produits qui perturberaient leurs propres approvisionnements. Alors : blocage de certaines enseignes dans leurs développements locaux ? Renforcement des réglementations à l’installation ? Rejet des investissements étrangers dans les enseignes françaises (même celles en difficulté) ? A l’inverse, tentatives de contraintes des extensions internationales de structures françaises ? Mise en place de quotas de produits locaux ? …. La plupart de nos enseignes seraient directement concernées et constituerait probablement un tsunami sur notre paysage commercial.
Horizon 2035-2045 : Vers un conflit des modèles sociaux ?
Une autre facette de la démondialisation nécessite à plus long terme d’être interrogée. Parallèlement au rejet d’un modèle libertaire en termes de mœurs, on observe le retour de la religion dans le temporel, en Occident comme ailleurs dans le monde. Partiellement souchée sur les interrogations face aux évolutions démographiques et la remise en cause des modèles de consommation, perçues comme moteurs d’une crise autant environnementale que sociale, ce rejet pourrait en profondeur redessiner les contours géopolitiques mondiaux.
Le XXIe siècle sera spirituel ![5]
Plusieurs signaux faibles méritent peut-être d’être analysés conjointement. Pour ne prendre que quelques exemples. Le président Poutine se réfère à Dieu dans sa lutte contre l’Occident du Mal. Le premier conseil des ministres du nouveau mandat du président D. Trump commence par une prière, alors que son vice-président rappelle sa conversion récente et s’oppose au Pape François, ou encore que le Secrétaire d’Etat Marco Rubio porte ostensiblement à la télévision des signes religieux sur son visage le Mercredi des Cendres. Depuis plusieurs années déjà Narendra Modi, premier ministre indien valorise la religion hindoue, allant jusqu’à interdire à certains commerçants, notamment musulmans, d’ouvrir pendant les fêtes religieuses. Même le gouvernement chinois laisse peu à peu le confucianisme reprendre une place dans la vie de sa population.
Cette remontée d’une religion vécue intensément, dont on pourrait questionner la liaison avec la consommation de consolation évoquée précédemment, ne va-t-elle pas constituer le nouveau « grand récit » de nombre de pays ? De manière imagée, ne va-t-on pas passer d’un monde dominé par une « american way of life », portée par un modèle technologique productiviste et défendu par la « pax americana » à celui d’un retour plus ou moins fondamentaliste à des modes de vie dictés par les enseignements religieux, s’opposant à certains modèles de production et de consommation ? Autrement dit, pourrait-on (devrait-on ?) interpréter la politique extérieure américaine, moins comme une approche économique qu’idéologique ? La menace des droits de douane ne serait-elle pas le faux nez d’une demande plus profonde faites aux autres pays de réformer leurs modes de vie et de rejeter ce qui constitue dans certains pays des avancées sociales majeures et pour d’autres sont perçues comme des signes de décadence ?
Que l’on ne s’y trompe pas, certains acteurs du commerce sont déjà localement obligés de se poser la question. Le retour de dogmes religieux stricts ne va-t-il pas redéfinir en profondeur les attitudes, les motivations et les comportements d’achat dans de nombreux pays, d’une partie importante de la population, qui sans être majoritaire, nécessiterait d’être prise en compte ? Certaines pratiques de consommation ne vont-elles pas être remises en cause ? Comment les enseignes vont-elles s’adapter à la nécessité d’offres de plus en plus spécifiques et fragmentées ? Comment vont-elles adapter leur communication dans un environnement de plus en plus susceptible de critiques et de boycotts, sur les réseaux sociaux, comme dans les magasins ?
Observer ce phénomène, sans en tirer les conséquences pour le commerce, c’est ignorer la remise en cause de nos chaînes de valeur, le plus souvent mondiales, les potentielles difficultés d’accès à certaines ressources ou productions stratégiques, la remise en cause des grands équilibres internationaux, notamment en termes de normes ou encore les nécessaires restructurations du secteur du commerce face à de nouvelles contraintes et alliances géopolitiques.
Un nouveau monde à explorer et à inventer pour la consommation et le commerce ?
Cette évolution pourrait bien sûr offrir de nouvelles opportunités pour des ports secondaires et des hubs logistiques alternatifs, modifiant les routes commerciales établies. Les enseignes de distribution devront adapter leurs stratégies logistiques à ces nouvelles configurations, révisant potentiellement leurs implantations et leurs réseaux de distribution, mais aussi repensant leurs structures de coûts, alors que les marges restent faibles.
Pour les acteurs du commerce, cette évolution impliquera des adaptations dans la conception des produits, leurs modes de fabrication et la structure des chaînes d’approvisionnement. La compétition accrue pour ces ressources pourrait également influencer les prix et la disponibilité de nombreux produits de consommation, obligeant les distributeurs à développer des alternatives et des stratégies d’approvisionnement innovantes.
Cette restructuration du secteur s’accompagnera probablement d’innovations dans les modèles de distribution, adaptées aux nouvelles contraintes environnementales et géopolitiques. Les enseignes devront concilier impératifs de rentabilité, attentes des consommateurs et réalités géopolitiques dans leurs stratégies de développement.
Les acteurs du commerce sauront-ils prendre les bonnes décisions ?
La question que nous pose l’émergence d’un monde différent, avec des règles inédites ou oubliées, est d’abord celle d’un réel déficit de prospective, de stratégie et d’évaluation dans les entreprises, et notamment celles liées aux activités commerciales.
Cela fait presque quarante ans que les praticiens les plus éminents du marketing et de la publicité expliquent la fin du « mass-market », terme plus parlant idéologiquement que son équivalent français de « marché de masse ». On pourrait reprendre par exemple, le sommaire du premier chapitre du livre de Rapp et Collins de 1987 « Maxi Marketing » décrivant le marché « actuel de cette époque » .
- la démassification du marché
- les transformations de la famille [américaine]
- le déclin de la fidélité à l’égard des marques
- la déréglementation de nouvelles façons d’acheter et de payer
- le développement du marketing sur base de données
- le développement de l’économie de services
- l’épanouissement de la société de l’information
- la prolifération des nouveaux produits
- la multiplication des circuits de distribution
- l’explosion des bons de réductions
- la perte d’efficacité de la publicité TV
Pourtant il est encore plutôt courant de rencontrer des dirigeants, même jeunes, faisant encore référence à ce concept et continuant à en appliquer des recettes pourtant largement obsolètes. On pourrait ici parler d’aveuglement face aux « éléphants noirs » ou à de « l’inconnu connu ». Pour mieux préparer l’avenir, nous devons nous appliquer à un exercice de rétrospective et nous interroger. Avons-nous tiré toutes les conséquences stratégiques et opérationnelles de ces évolutions ? Avons-nous réellement changé nos pratiques marketing et nos choix d’investissements dans cette nouvelle donne ?
Peut-être devrions nous, dans une logique comparative[6], revenir sur les causes de la désindustrialisation française et nous demander si certaines d’entre-elles ne s’appliqueraient pas aujourd’hui au commerce. Parler de désindustrialisation revient souvent à évoquer la complexité administrative, le poids de la fiscalité ou encore celui de la dette. Pourtant dans un article fondateur de 2015, Michel Aglietta et Xavier Ragot analysent tout autrement les causes et les remèdes à l’érosion du tissu productif en France. Ils rappellent qu’« … il faut revenir à l’évolution des coûts des principaux facteurs de production. En effet, la production des biens et services requiert l’utilisation de nombreux facteurs de production : des biens et machines (le capital physique), le travail, l’énergie, l’immobilier, etc. »[7]. En comparant, les évolutions contrastées de l’Allemagne et de la France, ils montrent comment nous avons « oublié » de prendre en compte d’autres facteurs : prix immobiliers, difficultés d’adaptation des entreprises aux changements macroéconomiques, financiarisation de la gouvernance des entreprises incompatibles avec des stratégies de long terme, ….
Alors espérons que nous saurons ne pas reproduire nos erreurs de jugements. « La définition de la folie, c’est de faire la même chose encore et encore en espérant obtenir des résultats différents« [8].
[1] Papon, P. (2024). La réindustrialisation de la France : perspectives et contraintes. Futuribles.
[2] Approche adoptée par de nombreuses entreprises internationales, notamment européennes, qui consiste à ne plus dépendre exclusivement de la Chine pour leur production ou leur approvisionnement, mais à diversifier leurs activités en s’implantant dans d’autres pays, principalement asiatiques.
[3] https://www.cna-asso.fr/lactualite-du-cna/la-vigie-n3-la-face-cachee-de-la-croissance-demographique-mondiale-118.html
[4] La consommation de consolation désigne un comportement d’achat caractérisé par l’acquisition de produits ou services dans le but principal d’apporter un réconfort émotionnel passager face à une difficulté ou un mal-être. Selon Cédric Ducrocq, expert du commerce et de la consommation, ce type de comportement explique le succès de Shein, Temu ou Action.
[5] On reprendra ici cette phrase souvent attribuée à André Malraux, dans le sens que rapportait en 1975, son ancien collaborateur, André Holleaux : « Le siècle prochain pourrait connaître un grand mouvement spirituel : nouvelle religion, métamorphose du christianisme — aussi imprévisible pour n[ou]s que le fut celui-ci pour les philosophes de Rome, qui […] croyaient […] que le successeur serait le stoïcisme, ne pensaient pas aux chrétiens ».
[6] benchmark
[7] Aglietta, M. et Ragot, X. (2015) . Érosion du tissu productif en France Causes et remèdes. Revue de l’OFCE, N° 142(6), 95-150. https://doi.org/10.3917/reof.142.0095.
[8] Citation très souvent attribuée à Albert Einstein dans la culture populaire.