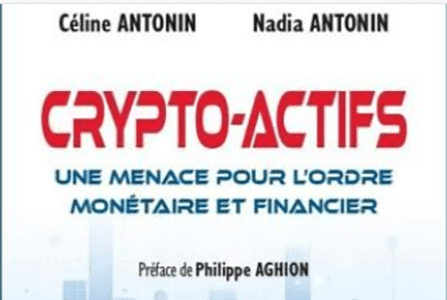Dans la préface de l’ouvrage intitulé « Crypto-actifs : une menace pour l’ordre monétaire et financier », Philippe Aghion, prix Nobel d’économie 2025, s’inquiète, comme les auteurs de l’ouvrage précité, de la montée en charge des crypto-actifs et d’un certain engouement auprès des particuliers.

Nadia Antonin, membre de l’Académie des Sciences commerciales, a coécrit avec Céline Antonin, économiste senior à l’OFCE (centre de recherche de Sciences Po) et chercheur associé au Laboratoire d’économie de l’innovation du Collège de France, l’ouvrage intitulé « Crypto-actifs : une menace pour l’ordre monétaire et financier » (2025).
La préface de cet ouvrage a été rédigée par Philippe Aghion, Professeur au Collège de France, à la London School of Economics et à l’INSEAD, qui a reçu le 13 octobre 2025 le prix Nobel d’économie 2025. Cette récompense, partagée avec Joel Mokyr (américano-israélien) et Peter Howitt (canadien), vient couronner leur théorie de la croissance schumpétérienne, fondée sur l’innovation qui émerge du processus de destruction créatrice[1].
Pour en revenir à l’ouvrage des crypto-actifs, Philippe Aghion le qualifie de « livre de référence pour comprendre les enjeux et les menaces des crypto-actifs » eu égard « à la rigueur et à la complétude de ses analyses ». Pour cet économiste, « ce livre très bien écrit, présente de façon claire et précise des concepts et des mécanismes de plus en plus techniques, qui sont souvent non maitrisés et utilisés de manière vague et confuse ».
Comme le souligne le préfacier, cet ouvrage est « novateur et engagé. Beaucoup de livres ont été écrits sur les crypto-actifs – notamment le bitcoin -, essentiellement avec le prisme récurrent : « faut-il investir dans les crypto-actifs ? ». En revanche, peu d’ouvrages analysent le risque pour le système monétaire et financier ».
« Convaincu que les crypto-actifs ne sont pas l’avenir de la monnaie, Philippe Aghion souhaite revenir sur deux points :
– La concurrence entre monnaie publique et monnaie privée. Il écrit : « N’en déplaise à Friedrich von Hayek (auteur de l’ouvrage « Denationalisation of Money » 1976), la monnaie n’est pas un bien comme un autre. Elle nécessite la confiance, elle s’appuie sur un contrat social. Autant je crois fermement aux vertus de la concurrence dans le domaine des biens et services, autant je considère que la monnaie échappe à cette logique, en ce qu’elle est un instrument du contrat social. Elle nécessite une confiance, que seule une autorité légitime est susceptible d’incarner ».
– L’idée défendue par les partisans d’un système monétaire anonyme et décentralisé selon laquelle la politique monétaire serait impuissante. En s’appuyant sur le discours du « whatever it takes » prononcé en 2012 par Mario Draghi, alors Président de la Banque centrale européenne, Philippe Aghion illustre « l’importance d’une autorité monétaire crédible, identifiable, capable de rassurer les investisseurs ». Il poursuit : « Chose impossible pour un système monétaire anonyme et désincarné. Par ailleurs, cela montre le rôle de la politique monétaire comme outil de stabilisation conjoncturelle. Affaiblir cet outil, c’est d’une certaine façon nier ce qu’un siècle de recherche économique a apporté en matière de gestion des crises ».
Enfin, concernant la blockchain (chaîne de blocs en français), qui représente « une innovation dans le domaine monétaire et financier », il s’interroge sur sa désirabilité. Il conclut la préface en déclarant : « Pour les raisons que j’ai évoquées, et comme le démontre très bien ce livre, quoique les crypto-actifs soient une innovation dans le domaine monétaire, leur développement n’est pas souhaitable. Leur nature non régulée, leur volatilité en font des instruments dangereux pour l’économie globale. L’innovation ne doit pas être un but en soi : elle doit être jugée sur ses effets concrets et son apport à la stabilité économique et sociale ».
[1] Dans un ouvrage coécrit par Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Brunel, intitulé « Le pouvoir de la destruction créatrice » (Odile Jacob, 2020), les auteurs résument ainsi ce concept : « La destruction créatrice est le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment rendre les technologies et activités existantes obsolètes. » Il y ajoutent une dimension sociale : « Les emplois nouvellement créés viennent sans cesse remplacer les emplois existants. »